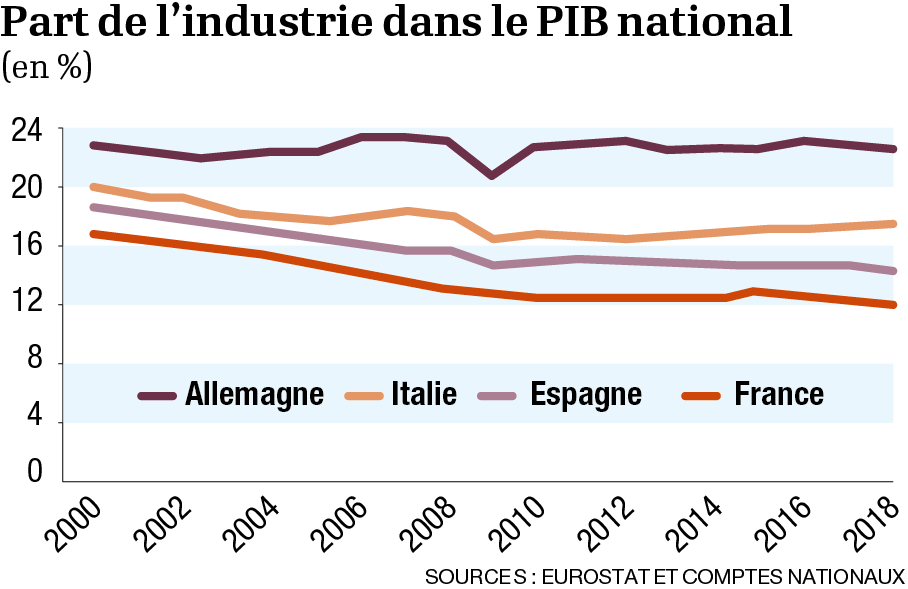Constat
La technologie est un virage incontournable de nos sociétés contemporaines. Le monde du droit n’en est pas épargné. La « numérisation » de la justice peut être considérée comme un avantage considérable, à condition que les acteurs de ce monde n’en soient pas de simples spectateurs, mais bien des acteurs. Parmi eux, l’avocat y joue un rôle majeur au service de sa profession et doit dès à présent faire de ces technologies des atouts, au lieu de les considérer comme une obsolescence programmée du métier. Aujourd’hui, il est inévitable de souligner que cette profession a profondément changé. Certains professionnels considèrent qu’elle traverse une crise profonde, d’autant plus accrue du fait de l’apparition de la Covid-19.
Ce qui ne fonctionne pas
Certaines études démontrent que nombreux sont les justiciables qui éprouvent un sentiment de défiance à l’égard de la justice française. Un rapport récent de l’IFOP, démontre que l’appareil judiciaire inspire de la défiance à 47% des citoyens. De plus, dans une étude d’opinion présentée le 10 janvier 2014 à l’occasion du colloque sur la justice du XXIe siècle, 66% des français considéraient déjà que la justice n’a pas un fonctionnement moderne et étaient favorables à l’introduction du numérique dans les tribunaux. Plus de 80% d’entre eux pensaient alors que les démarches dites « pratiques », comme la prise ou la confirmation de rendez-vous ainsi que le téléchargement des pièces justificatives, devraient se faire par internet.
Les avocats, qui constituent l’un des piliers essentiels du système judiciaire français, ont un rôle crucial dans cette remise en confiance des citoyens envers la justice. Mais pour ce faire, ils doivent apporter une innovation numérique majeure à leur profession. Près de 30% des avocats qui quittent la robe après dix ans de carrière à cause des facteurs de lassitude, de rejet mais aussi d’une rémunération jugée trop basse par rapport à l’investissement que le métier demande (Rapport HAERI portant sur l’avenir du métier d’avocat destiné au Ministère de La Justice, février 2017).
Cette innovation devient urgente face au développement de plates-formes et de la legaltech qui bousculent toute une profession. En effet, ces nouveaux mécanismes qui proposent entre autres des services standardisés pour un prix modique, viennent révolutionner une pratique pourtant bien établie. Sur ce point, 28% des avocats redoutent le possible remplacement de l’humain par la technologie. Si des poursuites ont été engagées par des instances ordinales envers certaines plates-formes qui prétendent remplacer les avocats, celles-ci se sont soldées par un échec qui amène à une réaction urgente de la part des barreaux français.
Propositions
Premièrement, l’avocat doit plus que jamais faire progresser son rôle de représentation de son client dont les besoins se numérisent. La communication numérisée pour simplement apporter des nouvelles de l’avancement du dossier par un système de notification devient intéressante. Par exemple, cela est envisageable grâce à des répertoires partagés et des formulaires intelligents. Le but est alors de dégager du temps afin de mettre en œuvre une approche collaborative avec les clients, dans le but de défendre une seule et même cause.
Ensuite, les cabinets d’avocats doivent parvenir à une meilleure organisation du travail pour en obtenir de meilleures prestations grâce à la digitalisation. L’utilisation de la legaltech devient ici intéressante, afin d’en obtenir un gain de temps considérable pour traiter des aspects spécifiques et complexes du droit et ainsi consacrer moins de temps pour des tâches purement administratives. Certains outils deviennent alors de véritables supports dans la recherche d’une stratégie. On peut citer le cas de la « due diligence ». Cette autre façon de travailler permet notamment d’évaluer à juste titre, la place des jeunes collaborateurs ou des stagiaires. Ils pourront alors se concentrer sur des activités bien plus valorisantes et même apporter leur regard neuf sur un dossier en parfaite osmose avec l’expérience aiguisée de l’avocat senior.
Par ailleurs, les coopérations interprofessionnelles grâce au digital doivent se généraliser. Cela passe par la création d’un réseau pluridisciplinaire composé de juristes, de techniciens en informatique dans l’optique d’apporter une réponse juridique et numérique continue aux clients en répondant à leurs besoins. Elles peuvent toucher de nombreuses spécialités du droit. Par exemple un avocat spécialisé en responsabilité médicale trouvera un intérêt à travailler avec des hôpitaux ou des psychologues. Aussi, les barreaux français peuvent collaborer avec des incubateurs et collaborer avec des legaltech implantées en France.
Enfin, face à ces enjeux, il apparait primordial d’organiser des formations solides qui abordent l’ensemble de ces sujets. Cela passe tout d’abord par la formation des futurs juristes au sein des facultés et des Instituts d’Etudes Judiciaires. D’ailleurs, des parrainages virtuels de jeunes juristes pourraient s’opérer.
Les juristes doivent faire de ces outils de véritables avantages qui permettront de replacer, contrairement à ce que l’on pourrait penser et plus que jamais, l’humain au cœur de la profession en se recentrant notamment sur le développement de services nouveaux et des stratégies performantes. Le juriste de demain sera un techno-humaniste qui placera l’humain au cœur de son action quotidienne, grâce à tous ces supports, sans déroger à une certaine déontologie.
Ambrine WIART
Juriste en Responsabilité Médicale
Ancienne élue à St.-André-Lez-Lille
Sacha GAILLARD
Adjoint au maire
Ville de Saint-Cloud
Président-fondateur d’EspriTerritoires